 Lecture – rencontre au BOOKSTORE de Biarritz le 9 juin 2012 à 17h autour de mon dernier titre chez Cheyne Editeur “Des métamorphoses”
Lecture – rencontre au BOOKSTORE de Biarritz le 9 juin 2012 à 17h autour de mon dernier titre chez Cheyne Editeur “Des métamorphoses”
Archives mensuelles : mai 2012
Phaéthon chez Ovide
« ta mère, tu la crois sur tout,
Espèce de fou, tu es gonflé de l’image d’un faux père ! »
Phaéthon rougit, réprime sous la honte la colère
Puis raconte à Clymène, sa mère, l’insulte d’Epaphus.
« ça va te faire mal, ma mère, mais moi, libre,
Moi, fougueux, je me suis tu. J’ai trop honte :
On a pu me traiter, je n’ai pas pu nier.
Si je suis vraiment de souche céleste,
Donne-moi la marque de ma naissance, attache-moi au ciel. »
Il dit. Il enlace le cou de sa mère,
Et sur sa tête, sur celle de Mérops, sur les noces de ses sœurs,
La supplie de lui offrir le signe de son véritable père.
On ne sait pas si ce sont les prières de Phaéthon ou la colère
De l’accusation portée contre elle qui émeuvent le plus Clymène : au ciel
Elle tend ses bras et regarde la lumière du soleil :
« Par cet astre aux rayons qui tremblent merveilleusement,
Par cet astre qui nous entend et nous voit, enfant, je te le jure,
De lui que tu regardes, de lui qui tempère le monde,
Le soleil, tu es fils. Si je dis des mensonges, qu’il m’empêche
De voir ; que cette lumière dans mes yeux soit la dernière.
Mais ce n’est pas un gros effort de connaître la maison de ton père.
La maison d’où il se lève est voisine de la nôtre.
Si tu le veux, va, apprends par toi-même. »
Il s’élance aussitôt, joyeux des paroles de sa mère,
Phaéthon, et il prend dans la pensée tout le ciel.
Par ses terres d’Ethiopie, par celles de l’Inde, posées sous les feux
Brillants, il passe et arrive, infatigable, au lieu d’origine de son père.
Le palais du Soleil était là-haut, sur les colonnes de l’air,
Clair, d’or qui palpite et d’un cuivre de feu.
L’ivoire resplendissant couvrait le faîte du toit,
Les doubles portes irradiaient d’une lumière d’argent.
L’art surpassait la matière ; c’est Vulcain qui
A brodé les eaux qui entourent les terres du milieu,
Le globe terrestre et le ciel suspendu sur le globe.
L’onde possède des dieux bleus, Triton l’harmonieux,
Protée le changeant, et, pressant de ses bras
Le dos atroce des baleines, Egéon.
Doris et ses filles, les unes on les voit nager,
D’autres sur un rocher sèchent leurs cheveux verts,
D’autres voyagent sur un poisson. Toutes n’ont pas même visage,
Mais presque, comme c’est chez les sœurs.
La terre porte des hommes et des villes et des forêts et des bêtes,
Des fleuves, des nymphes et d’autres divinités des campagnes.
Au-dessus, est posée une image du ciel qui luit
Et les constellations, six sur la porte de droite, six sur celle de gauche.
Quand l’enfant de Clymène au seuil montant
Arrive, entre sous le toit de ce père possible,
Il précipite sa marche vers le visage de celui-ci
Mais très vite s’arrête. De plus près il ne supporte pas
Sa lumière. Vêtu d’un habit pourpre il était assis,
Phoebus, sur un trône brillant d’émeraudes claires.
A droite et à gauche, étaient le Jour, le Mois, l’Année,
Les siècles et, posées à espaces égaux, les Heures.
Le Printemps était là, avec sa couronne fleurie,
L’Eté nu était là, qui portait des guirlandes d’épis,
L’Automne était là, sale de raisins piétinés
Et l’Hiver glacial, hirsute de cheveux blancs.
Là, au milieu, effrayé par la nouveauté des choses,
Se tenait le jeune homme. Le Soleil, de ses yeux qui voient tout, l’aperçoit.
«Quelle est la cause de ton voyage, dit-il, pourquoi venir à cette hauteur,
Mon enfant, Phaéthon, qu’un père ne peut pas renier ? »
Celui-ci répond : « Oh lumière commune du monde immense
Phoebus mon père, si tu me laisses l’usage de ce mot,
Si Clymène ne cache pas sa faute sous une image mensongère,
Donne-moi des preuves, père, pour que je me croie ton vrai
Fils, de mon esprit retire l’erreur».
Il dit. Le père dépose les rayons qui brillent
tout autour de sa tête, lui demande d’avancer
Et l’embrasse : « on ne dira que tu n’es pas mon fils,
Tu en es digne, Clymène a dit ta vraie naissance.
Pour que tu doutes moins, demande en cadeau ce que tu veux.
Je te le donnerai, tu le prendras. Sois témoin de mes promesses,
Marais par lequel jurent les dieux et inconnu de mes yeux. »
A peine a-t-il fini que Phaéthon demande le char paternel,
Pour un jour le droit de conduire les chevaux ailés.
Le père regrette d’avoir juré. Trois fois, quatre fois
Il secoue sa tête claire. « Téméraires, dit-il,
Mes paroles, dictées par les tiennes. Si je pouvais ne pas donner
Ce que j’ai promis. Je l’avoue, c’est la seule chose, enfant, que je te refuserais.
Je dois te dissuader : ton voeu n’est pas prudent,
Tu demandes beaucoup, Phaéthon, un cadeau
Qui ne convient ni à tes forces ni à tes années d’enfance.
Ton sort est mortel ; ce que tu demandes n’est pas mortel.
Plus que ce que les dieux peuvent toucher
Tu le veux, ignorant ; libre à chacun d’avoir confiance en soi,
Mais personne n’est assez fort pour s’installer sur le char de feu,
Sauf moi ; même le maître du vaste Olympe
Qui lance de sa main terrible la foudre féroce
Ne conduira pas mon char – et qu’avons-nous de plus grand que Jupiter ?
La route du début est escarpée et avec peine, frais au matin,
Mes chevaux la gravissent ; au milieu, la voilà, très haute dans le ciel,
D’où, moi-même, souvent, de voir la mer et les terres,
J’ai peur et ma poitrine éperdue tremble d’effroi,
A la fin la route descend, elle a besoin d’une conduite sûre :
Celle qui dans ses eaux du dessous m’accueille,
Téthys elle-même, craint toujours que je n’y sois précipité.
Ajoute que le ciel est pris dans un tournoiement sans fin,
Qu’il tire les hautes étoiles, les fait rouler en vif tourbillon.
Je fais effort contraire et l’élan ne me vainc pas qui vainc les autres,
Il m’emporte à l’opposé du cercle de la terre qui va.
Imagine que je te donne le char : que fais-tu ? Peux-tu aller
Contre les pôles qui tournent, sans que l’axe leste du ciel ne t’entraîne ?
Peut-être, là-bas y a-t-il des bois sacrés et des villes de dieux,
Rêves-tu, et des sanctuaires riches d’offrandes ?
Mais non : on fait le chemin à travers des pièges et des figures de bêtes.
Si tu tiens la route et n’es entraîné par aucune erreur,
Il te faudra quand même passer par les cornes du Taureau qui fait face,
Par l’arc d’Hémonie, par la bouche du Lion fauve,
Par celui qui plie ses bras en une longue courbe,
Le Scorpion, et par celui qui les plie dans l’autre sens, le Cancer.
Mes bêtes à quatre pattes, excitées par les feux,
Ceux de leur poitrine et ceux qu’elles soufflent par la bouche et les naseaux,
Tu ne peux pas les diriger. A peine me supportent-elles quand
Leurs esprits ardents les échauffent. Leur cou refuse la bride.
Toi, ne fais pas de moi l’auteur d’un cadeau de mort,
Mon fils, attention, tant qu’il est temps, change de vœu.
Pour croire que tu es enfant de mon sang,
Tu veux des preuves sûres ? Ma crainte est une preuve sûre,
Par une peur de père je prouve que je suis père. Vois
Sur mon visage ; si tu pouvais enfouir tes yeux dans ma poitrine
Et découvrir dedans mes angoisses de père !
Tout ce que le monde a de riche, regarde !
De tous les grands biens du ciel de la terre et de la mer,
Demande quelque chose, tu ne souffriras aucun refus.
Je te supplie de renoncer à une seule, qui a pour nom Punition
Et non Honneur. C’est une punition, Phaéthon, que tu demandes en cadeau !
Pourquoi, prends-tu mon cou dans tes bras câlins, inconscient ?
Ne doute pas. Je l’ai juré par les ondes du Styx, il te sera donné
Tout ce que tu désires ; mais désire avec plus de sagesse. »
Il avait fini ses conseils. Mais à ces paroles l’enfant résiste,
Chérit son projet et brûle du désir du char.
Rencontre avec… Marie Cosnay et Jérôme Lafargue Le 08/06/2012 – 18h15
 Quatre écrivains ont écrit 4 nouvelles inspirées des textes et chansons d’Alain Bashung, réunies par les éditions In8 dans un coffret. La Médiathèque reçoit deux d’entre eux (Marie Cosnay et Jérôme Lafargue) pour évoquer cette expérience inédite et pour un échange autour de la nouvelle littéraire, le court, style très tendance !
Quatre écrivains ont écrit 4 nouvelles inspirées des textes et chansons d’Alain Bashung, réunies par les éditions In8 dans un coffret. La Médiathèque reçoit deux d’entre eux (Marie Cosnay et Jérôme Lafargue) pour évoquer cette expérience inédite et pour un échange autour de la nouvelle littéraire, le court, style très tendance !
Lecture "Des métamorphoses" à l’Alinéa de Bayonne
 Lecture ” Des métamorphoses”
Lecture ” Des métamorphoses”
à l’Alinéa de Bayonne
Samedi 25 mai à 10h.
l'homme qui rit et ces filles dont les mères mouraient
Noémie Lefèbvre, radieux compagnon
à Toulouse je suis venue voir mon fils qui ne va pas très bien ou plutôt mon fils radieux dans cette façon de ne pas aller très bien dans le monde comme il va et qui prépare un long départ, j’ai reçu vendredi le numéro 3 de l’Impossible et dans un café de la rue Parghaminière samedi je relis Nos territoires de Noémie Lefèbvre, cependant un homme seul écrit des vers à côté en terrasse, cependant 4 jeunes filles aux talons démesurément hauts affirment haut et fort que c’est un scandale ce vote PS, elles disent Ils ont pas le monopole de l’humanité quand toute la misère du monde vient te piquer tes allocations que t’as plus droit à rien et pourtant t’as pas un rond et tu demandes 5 euros à ta grand-mère pour le cinéma
et plus tard mon fils infiniment radieux me dira Ne caricature pas mais j’ai entendu les filles parler haut et fort et un homme qui attendait quelqu’un écrivait sur un cahier et Nasser s’est présenté Je m’appelle Nasser et il a composé un poème il a dit et je crois qu’il me parlait Tu as manqué d’amour de mère j’ai dit Il n’y a plus de problème, il a dit Je ne suis pas ivre mais c’est vrai que j’aime l’ivresse et puis il est parti mais avant il a dit Tu dois aimer les livres moi aussi j’aime la littérature Artaud et Stendhal
j’aurais voulu malgré le bruit des 4 filles aux gros talons penser aux territoires de Noémie Lefèbvre qui explique qu’elle est partie du sien et qu’elle y est revenue ce jour-là avec sa nièce à qui il serait bon d’expliquer qu’il faut les quitter Nos territoires pour, je ne me souviens plus, y revenir ou pas, revenir c’est peut-être moi qui ajoute, je me souviens de tout le reste, d’Emma Bovary de Marcel Duchamp du camp tout près de l’autoroute mais pas de revenir, je voulais penser aux territoires, à partir et revenir parce que si je suis à Toulouse c’est pour mon fils radieux qui se prépare à partir pour revenir et je n’oublie pas que moi-même je suis partie d’un territoire à l’âge de partir et j’y suis revenue et n’ai pas du tout trouvé le même ou alors il était déplacé il ne parlait pas la même langue il n’avait rien à voir mais surtout Nos territoires, j’étais toujours en terrasse, j’avais appris qu’on pouvait ne pas les quitter, je me promettais bien de parler de ceux qui ne les ont pas quittés et sont devenus aussi subtils que ceux qui sont partis puis revenus, je les ai rencontrés ces quelques-uns, ils fabriquaient ici des petites maisons, des lieux, des pensées et il avaient quelques fois des parcours ahurissants et beaucoup d’amour et ils fabriquaient des chambres d’agriculture indépendantes et ils avaient des façons de consoler les leurs et ils étaient restés, ils revendiquaient calmement, sans arrogance, le droit de partir celui de partir revenir et celui de rester
mon fils qui va partir bientôt propose qu’on aille s’acheter des livres, je trouve sur la première table L’état des sentiments à l’âge adulte, je trouve dedans Victor Hugo et Mariama Sagna, une vision radieuse et une spéciale façon de dire et le week-end devient incroyable, Noémie Lefèvre m’accompagne jusqu’au bout et sur le chemin du retour au lieu de chercher à dire quelque chose sur le livre radieux qui est devenu mon compagnon je décide que j’en copierai un extrait, un extrait du moins mais dommage que je puisse pas tout recopier.
« Tu vois j’aurais dit à quelqu’un si j’avais quelqu’un à qui le dire, se détacher et pas déranger sont comme deux tendances opposées qui font de la vieillesse un naufrage où la solitude est volontaire et combattue à la fois, s’impose en courants contraires qui vont t’emporter de ci de là sur ton petit navire d’abandon qui n’a encore jamais navigué, entouré de profondeurs et de légèreté, loin de murs ville pont on y verrait soudain clair à mourir, trop pour ne pas y aller, comme un djinn qui aurait une dernière fois survolé les cités et soufflé les chandelles de l’éclairage public et laissé à leur folie les gens comme ils sont, innocents dans les moiteurs nocturnes, on partirait au-dessus des grands espaces maritimes, et de l’aube au couchant on verrait les changements de lumière, du matin si brutal et resplendissant au midi insolent et aux heures qui s’allongent en bleus moins brillants, presque immobiles, finissant en agonie de soleil, adieu la vie adieu les animaux et adieu les grands pouvoirs, Victor Hugo et Mariama sur le lit dérivant au-dessus de l’océan africain, puis le Samu est arrivé »
Pages 176-77
L’Etat des sentiments à l’âge adulte
Noémie Lefèbvre
Nathalie Loubeyre à Patras
Nathalie Loubeyre est réalisatrice. Elle revient aujourd’hui de Patras (Grèce), où elle tourne un film sur la politique européenne de « maîtrise des flux ».

À l’heure où la « bêtise systémique » qui gouverne le monde menace sa propre survie, où le projet européen dévoile son vrai visage, antidémocratique et inégalitaire, où se profile une forme de « fascisme financier » dont les institutions européennes sont le fer de lance, il est une réalité dont personne ne parle ou presque. Pourtant, elle dessine bien plus sûrement que d’autres le visage de cette Europe en marche vers le pire.
Cette réalité, tout le monde la connaît, mais nous sommes très peu à la voir. Tout le monde en voit des images, mais très peu en prennent la véritable mesure. Pourtant, elle n’est pas difficile à observer de visu, pour qui s’en donne la peine. Car même si elle se joue souvent loin des regards, elle se donne néanmoins à voir en de nombreux endroits du territoire de l’Europe, inhumaine, coercitive et violente.
Pourtant, en dehors des « initiés », militants associatifs, politiques ou religieux, qui se démènent comme ils peuvent pour la combattre ou soulager les souffrances qu’elle génère, elle n’arrive à provoquer dans le grand public qu’une grande indifférence ou, au mieux, une indignation passagère, une déploration convenue, une résignation presque complice.
Moi, je l’avais déjà touchée du doigt (ou plutôt de la caméra) en 2008, à Calais [1]. J’avais vu et filmé des hommes, des femmes et des enfants venus en Europe pour échapper à leurs destins de misère, d’arbitraire ou de violence, considérés sur notre sol comme indésirables, laissés dehors sans protection, harcelés par la police. À mon retour, j’avais ressenti ce terrible décalage entre mon indignation et le peu d’écho qu’elle rencontrait auprès de mes concitoyens, même les plus avertis, semble-t-il résignés au pire. J’avais constaté l’impuissance des mots, voire des images, à faire partager les choses éprouvées. J’avais connu cette interrogation anxieuse qui taraude : quelle est la vision juste ? Celle qui s’est frottée au réel et qui pressent l’ampleur du crime ? Ou bien celle qui, à l’abri des écrans et des écrits, peut relativiser ? Le temps a passé et fait son œuvre sinon d’oubli, du moins de mise à distance. J’ai monté le film, je l’ai accompagné, toute une année durant, dans toute la France, j’ai participé à des débats, j’ai inlassablement témoigné.
Je reviens aujourd’hui de Patras, où je tourne un nouveau film, et ma colère est plus grande encore. Mon sentiment que le pire est à l’œuvre, dans cette Europe qui décline, est décuplé. Car je l’ai revue de près, cette hideuse réalité qui indiffère tellement mes concitoyens, occupés aujourd’hui par la crise, avec son cortège légitime d’angoisses individuelles, d’indignations et de révoltes collectives. Je l’ai vu de nouveau, ce miroir tendu sur ce que nous sommes devenus et qui m’avait tellement ébranlée. J’y ai vu des hommes et des enfants venus d’Afghanistan, du Soudan, d’Érythrée, et d’autres zones de conflits pourtant reconnues, empêchés de faire-valoir leur droit à l’asile. Je les ai vus survivre comme des chiens dans une immense usine désaffectée, dangereuse, envahie d’immondices et de rats.
Des hommes courageux, déterminés, souvent éduqués, parfois même bardés de diplômes, en guenilles, sales, réduits depuis des mois, parfois même des années, à fouiller les poubelles pour se nourrir, à boire de l’eau non potable pour ne pas mourir, à charrier de lourds bidons sur des centaines de mètres pour pouvoir se laver et se faire à manger, à dormir dans des trous pour échapper aux rafles. J’ai vu des pères de famille, des maris empêchés de rejoindre leur femme, leurs enfants restés en Angleterre alors qu’ils avaient été rejetés sur les routes par des décisions administratives absurdes ou criminelles. Ils passaient leurs soirées dans un cybercafé, sur Skype, pour maintenir vaille que vaille avec leur famille les liens qui s’effilochent, mois après mois, année après année. J’ai vu un jeune homme devenu mutique détruire chaque soir la flûte qu’il avait fabriquée la journée. J’ai vu un enfant descendre en rappel la façade de l’usine où il survit pour échapper à la police.
La situation à Patras est pire encore qu’à Calais. D’abord parce que ces réfugiés n’ont aucune chance d’obtenir l’asile. En vertu du règlement européen dit de « Dublin II », la Grèce est le seul pays où ils sont autorisés à le demander, mais, aujourd’hui saturée et à genoux, elle en accorde très peu. Ensuite parce qu’ils y sont prisonniers, la Grèce n’ayant pas de frontière avec le reste de l’espace Schengen, sinon la mer. (Et les frontières du reste de l’Europe sont très bien gardées.) Enfin, parce qu’ils n’ont aucune chance de survivre dignement, même dans l’illégalité à laquelle ils sont acculés. La crise qui secoue si durement le pays les a privés des petits boulots au noir grâce auxquels ils survivaient. Les associations ou ONG qui tentent de les aider, aujourd’hui privées de moyens ou tout simplement débordées, sont incapables, malgré leur bonne volonté, d’assurer une aide humanitaire minimum.
Le piège s’est refermé sur ces hommes, qui ont pour beaucoup vécu le pire chez eux, au Darfour, en Afghanistan ou en Érythrée. Ils ne peuvent y retourner, sont sans espoir d’être régularisés, sans moyen de subsister dignement et sans possibilité de sortir de ce pays. La perspective d’une vie normale et digne s’est évaporée pour toujours.
De la frontière turque, relativement facile à traverser, il en arrive tous les jours un peu plus, affluant de contrées hostiles, papillons affolés attirés par la flamme à laquelle ils vont se brûler. Ils sont donc tous les jours un peu plus nombreux, abandonnés de presque tous, condamnés à une vie de parias, ignorés, voire rejetés par une grande partie de la population locale. Ils sont acculés à une vie quasi animale faite de lutte quotidienne pour la survie, mais aussi d’humiliations et de violences policières. Depuis les résidences voisines de l’usine où ils survivent, des gens leur tirent dessus avec du plomb de chasse. Les policiers débarquent régulièrement, brûlant les maigres affaires, pourtant vitales, qu’ils ont pu accumuler : couvertures, vêtements, ustensiles de cuisine. Certains sont arrêtés, emmenés à Athènes puis relâchés, ce qui les oblige à revenir parfois à pied, faute d’argent pour payer un billet de train ou de car. À l’heure où les camions traversent la ville pour embarquer sur les ferries vers l’Italie, Patras grouille d’ombres noires qui se glissent sous les camions arrêtés aux feux rouges, pour se cacher sous les essieux et tenter d’embarquer. Un spectacle auquel les habitants de Patras, blasés, ne s’attardent plus.
De nombreux camionneurs, les apercevant dans le rétroviseur, leur reculent dessus pour s’en débarrasser. La veille de notre arrivée, un migrant est mort écrasé. Quand ils sont découverts, aux contrôles du port, la police les bastonne violemment et ils sont mordus par les chiens dressés pour les débusquer. Quelques-uns, très peu, finissent par réussir, après des mois, parfois des années, de tentatives quotidiennes, échappant ainsi à ce vaste camp de rétention à ciel ouvert, sans gardiens ni barbelés, mais redoutablement bien fermé, que la Grèce est devenue. Lorsqu’ils arrivent en Italie, ils sont chargés d’appeler les autres, histoire d’entretenir un espoir qui a tellement de mal à subsister.
Aujourd’hui le pays parle de se lancer dans un vaste plan de construction de centres de rétention. Une trentaine sont prévus sur tout le territoire, qui seraient financés par l’Europe. Les arrestations ont commencé, pour « nettoyer » Athènes et remplir le premier d’entre eux, aménagé dans une ancienne caserne militaire. La prison à ciel ouvert va donc peut-être se transformer en prison fermée. La Grèce en crise va peut-être finalement trouver un nouveau débouché : l’industrie de la rétention administrative, dûment appointée par l’Europe. Quelques milliers d’emplois en perspective, n’en doutons pas. Même si nul ne sait ce qu’il adviendra des « retenus » une fois le délai de rétention maximum dépassé (renvoyés chez eux ? Rejetés à la rue ?), d’aucuns pourront penser qu’au moins pendant leur rétention ces hommes, ces femmes et ces enfants seront nourris, vêtus, soignés.
C’est sans connaître les conditions de rétention en Grèce, qui ont déjà été dénoncées par de nombreuses ONG. Un logisticien de Médecins du monde, qui leur rend régulièrement visite et que j’ai interviewé, parle de corps si entassés dans les cellules qu’il peut à peine les approcher sans marcher sur les uns ou les autres. Il raconte l’absence de promenade, le repas unique, l’odeur pestilentielle parce que la cellule ne peut jamais être vidée et donc lavée ou désinfectée, les maladies de peau, les affections respiratoires qui prolifèrent, la loi du plus fort qui s’installe pour vendre aux plus faibles la place pour se coucher ou la nourriture abandonnée par les gardiens à l’entrée de la cellule.
Cette situation en Grèce est connue, puisque la Cour européenne des droits de l’homme, statuant sur une affaire individuelle en janvier 2011, a déclaré que la Grèce violait les droits de l’homme d’un réfugié en le détenant dans des conditions inhumaines et en le laissant sans abri. À la suite de cette décision, certains pays ont d’ailleurs suspendu ou limité les renvois en Grèce exigés par les accords de Dublin (l’Allemagne, la Belgique, la Hollande, les pays scandinaves, le Royaume-Uni, par exemple, mais pas la France).
Mais quid des migrants qui y sont coincés depuis des mois, parfois des années, et pour longtemps encore sans doute et dont les droits sont tout aussi bafoués ? Ils sont environ 900, rien qu’à Patras, des dizaines de milliers ailleurs dans le pays. Personne en Europe ne semble s’en soucier, comptant sans doute qu’ils s’extraient par eux-mêmes, au prix d’années de souffrances et au risque de leur vie, de cet enfer où ils sont tombés. Et quid des renvois en Afghanistan, exécutés par la Grande-Bretagne, contre toutes les conventions internationales ? Un charter par semaine ! Les renvoyés n’ont alors d’autre option que de repartir et de finir de nouveau coincés à Patras, un jour ou l’autre.
Selon le Dictionnaire de la culture juridique, un « crime contre l’humanité », c’est la « violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d’un individu ou d’un groupe d’individus, inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux ». Comment appeler autrement ce que j’ai vu à Calais, à Patras, et que j’aurais pu voir en bien d’autres endroits en Europe aussi ? Cette violation manifeste et continue des droits fondamentaux, reconnue par la Cour européenne des droits de l’homme à propos de la Grèce, ne tombe pas du ciel comme la pluie ou la grêle. Elle est le résultat d’une politique délibérée décidée à Bruxelles. Celle qu’on nomme avec cynisme « maîtrise des flux », un euphémisme déshumanisant qui raconte bien, à lui seul, le crime en train de se commettre à l’abri des mots.
Enfin, comment ne pas voir le caractère « raciste » de ce crime, arc-boutés que nous sommes derrière notre « droit » à fermer nos frontières, dût-il nous conduire à nous renier, à cautionner le pire, voire à provoquer une hécatombe ? (Plusieurs dizaines de milliers de morts, noyés en Méditerranée ou ailleurs aux portes de l’Europe, selon les ONG qui tentent de les comptabiliser.) Car je me pose la question : qu’en serait-il si ces réfugiés, qu’ils soient politiques ou économiques, étaient blancs et chrétiens ? Nous feraient-ils aussi peur, au point qu’on leur refuse l’accueil et l’assistance dont ils ont tellement besoin ? Cela nous indifférerait-il autant de côtoyer leur désespoir et leur misère sur notre propre sol ? Parlerait-on à leur sujet de « flux » à « maîtriser » ? Les entasserait-on comme des animaux des mois durant dans des cellules sans jamais les faire sortir ? Les camionneurs reculeraient-ils sur eux ? Les riverains leur tireraient-ils dessus ? Ne verrait-on pas se dresser plus de personnalités médiatiques pour dénoncer, alerter, venir en aide ? Au vu du nombre de morts, n’aurait-on pas érigé des monuments, un peu partout aux portes de l’Europe ? (Seule Lampedusa l’a fait.) N’aurait-on pas imposé des minutes de silence dans les écoles pour les nombreux enfants qui figurent parmi ces victimes ?
Bien sûr, de nombreux militants de l’ombre, qu’ils soient associatifs, politiques, religieux, tentent depuis longtemps d’alerter l’opinion, de faire bouger les lignes, ou de soulager les souffrances. Mais que ne sont-ils davantage entendus, relayés, médiatisés ? Bien sûr que de nombreux journalistes rendent compte de ce qu’ils voient sur le terrain, mais pourquoi le terme de « crime contre l’humanité » n’est-il jamais prononcé ? Pourquoi ce problème n’est-il jamais déclaré « grande cause nationale » ? Au même titre que l’autisme ou la mortalité sur les routes ? Pourquoi ne prend-on pas acte de l’impossibilité qu’il y a à fermer les frontières sans provoquer des dizaines de milliers de morts et d’infinies souffrances, contraires à nos valeurs et à nos principes ? Devant l’importante mortalité des femmes avortées dans la clandestinité, n’a-t-on pas fini par accepter qu’elles le fassent légalement, malgré la réprobation morale que cela inspirait à l’époque ?
C’est qu’il faut bien voir les choses en face, même si ça fait mal : oui, ces hommes et ces femmes qui fuient leur pays sont presque tous noirs et basanés, et pour la plupart d’entre eux musulmans. Et dans notre peur de l’immigration, instrumentalisée par les politiques, il y a bien, derrière les alibis économiques, celle de voir ce « flot », qu’on imagine souvent constitué d’analphabètes, de polygames ou de terroristes potentiels, envahir notre belle Europe, métisser notre blanche population, salir nos belles coutumes, affaiblir notre niveau éducatif, et peut-être même ternir notre civilisation tellement supérieure. Comment ne pas voir que c’est au nom de cette « pureté » raciale et/ou culturelle à conserver, au nom de ce sentiment de supériorité, avoué ou inconscient, au nom de ces fantasmes les plus primitifs, bien plus que pour des considérations économiques, que sont bafouées les valeurs que nous brandissons comme les nôtres ? Plus personne aujourd’hui ne peut sérieusement soutenir que, dans une Europe en dépression démographique, l’apport humain que constituent les migrants ne soit pas une richesse, même s’il impose des défis à relever. D’aucuns disent même qu’il est indispensable, et qu’à vouloir s’en priver, l’Europe risque un jour ou l’autre de s’éteindre. Si c’est le chemin qu’elle choisit, c’est tout ce qu’elle aura mérité. Je suis de ceux qui pensent qu’elle peut encore en prendre un autre et que tout dépend de nous. Nous devons tous, chacun à notre place y travailler avec acharnement. Déjouer derrière chaque mot qui euphémise, chaque image qui banalise, chaque propos qui justifie, ce qu’Hannah Arendt a appelé la « banalité du mal ». Nous devons dénoncer, jour après jour, ce qu’il ne faut pas hésiter désormais à appeler par son vrai nom : un crime contre l’humanité. Et nous dresser pour empêcher qu’il se poursuive.
Pour notre avenir à long terme, bien sûr, mais aussi pour celui, bien plus proche, qui nous guette, celui d’un fascisme rampant et mortifère, dont ce crime est l’un des premiers forfaits, mais qui nous brisera tous, nous aussi, à plus ou moins brève échéance.
Nota Bene :
Nathalie Loubeyre est réalisatrice. Elle a obtenu le prix du documentaire de création au Festival du film des droits de l’homme de Paris en 2009 pour No Comment. Elle est en train de tourner la Mécanique des flux, sur la politique européenne de « maîtrise des flux ».
[1] No Comment, qui a obtenu le prix du documentaire de création au Festival des droits de l’homme de Paris en 2009.
Sommaire # 133 du Matricule des Anges
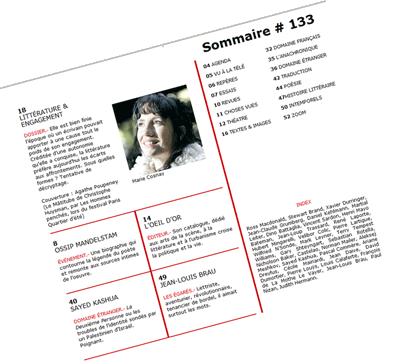 18
18
LITTÉRATURE & ENGAGEMENT
DOSSIER.- Elle est bien finie l’époque où un écrivain pouvait apporter à une cause tout le poids de son engagement. Créditée d’une autonomie qu’elle a conquise, la littérature préfère aujourd’hui les écarts aux affrontements. Sous quelles formes ? Tentative de décryptage.