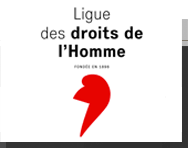 16 h 30 – 2è TABLE RONDE
16 h 30 – 2è TABLE RONDE
“Témoignage et engagement de l’écrit »
Table ronde avec Liana Lévi, Marie Cosnay, Salim Hatubou et Martine Laval (animatrice)
Archives mensuelles : février 2012
le viel homme la mer et le parti des mous
En période d’élections, le niveau de bêtise monte. Acteurs et destinataires le savent, la démagogie est du pain quotidien. Elle est même revendiquée (saisi à la radio, France Culture, il y a quelques jours, ceci : « la politique c’est parler beaucoup pour rien dire, Pompidou faisait ça très bien ». C’est Jean-Claude Carrière qui admirait). On le revendique et on l’analyse, l’art de la démagogie. Une façon de s’en vanter. C’est vieux. Quand on en a un peu honte on parle du populisme de ceux qui ne respectent pas tout à fait la bienséance des règles du jeu du semblant. Tout est donc dans l’art de ne rien dire, de ne dire aux pauvres que ce qu’ils savent trop bien ou craignent trop bien, le jeu est subtil, annonces, petites phrases, accusations, stratégie oratoire et chiffres, images, chiffres. La campagne a commencé, on nous dit qu’elle est violente. Il y a ceux qui acclament. Il y a ceux qui n’iront pas voter. Parmi eux quelques jeunes que je connais et des rêveurs qui croient à la rue tout de suite. Il y a ceux qui ne savent pas comment s’y prendre pour comprendre. Alors : tous pareils, gauche et droite.
Deleuze le disait, en période d’élection, c’est comme ça, c’est la bêtise, elle monte, on se laisse aller. Avec la bêtise, on fait monter la violence, ce qu’on appelle comme ça, ça ressemble plutôt à la cour de récréation (ou certaines salles de profs, enfin d’autres lieux clos et tristes). On fait monter, on s’aime bien un peu bête, un peu pseudo-violent….
En période d’élections, on achète moins de livres, les amis libraires le disent depuis longtemps.
Mais la bêtise cache des symptômes de maladies graves. La liste est longue. Le sort fait aux étrangers en situation régulière et irrégulière depuis 2005 n’a cessé de se dégrader. En 2007, 2008, on se demandait : cette politique xénophobe-là, ce n’est qu’à but électoraliste ? ça semblait suspect. Trop facile, trop évident comme réponse. Non, c’est que l’Europe avait peur. Peur d’elle-même et de ses failles, peur de sa défaite. Puis ça a été la crise. Puis les révolutions là-bas, de l’autre côté de la Méditerranée. On s’accroche à une misère de lois inutiles et absurdes qui se contredisent les unes les autres, on tente de contenir des milliers de personnes et malgré ces lois de l’Europe les personnes traversent les pays, passent les murs les mers ; rien n’arrête les élans que la raison la survie le désir et l’aventure commandent.
Ailleurs, dans des domaines autres, mêmes fantômes de bêtises, mêmes peurs, même certitude que c’en est fini des vieux modèles. Mais la certitude ne se laisse pas faire : on ne lâche pas l’affaire comme ça. C’est Gallimard qui demande des dédommagements à François Bon pour sa nouvelle traduction du Vieil homme et la mer, éditée récemment sur Publie.net. Pas de version numérique du Vieil homme et la mer chez Gallimard. Hemingway dans le domaine public aux USA et au Canada. 22 « exemplaires » numériques vendus. Traduction disponible chez Gallimard de Jean Dutourd, 1954. Bêtise ? Absurdité ? François Bon le dit bien, la traduction proposée par Gallimard est établie « selon les canons d’époque, faisant parler le pêcheur comme doit parler selon la littérature un illettré de Cuba. » On n’ira pas plus loin. On n’évoquera même pas le bonheur de traduire, retraduire, à quel point c’est se déplacer dans l’intelligence, à travers les terres et les langues. On n’ira pas plus loin tant la bêtise se dévoile toute seule, grasse. Il n’est pas question des 22 fois 2 euros et quelques de téléchargements. Il s’agit d’autre chose, évidemment. Un symptôme. C’est fini, l’édition d’antan. C’est fini et tout le monde le sait : ça ne marche pas, ça ne marche pour personne, ni pour les libraires ni pour de nombreux petits et moyens éditeurs qu’on pourrait citer ici et qui conservent une activité salariée à temps complet, ni pour de nombreux auteurs qu’on pourrait citer ici et qui conservent une activité salariée à temps complet, ni pour les distributeurs vraiment, ni même pour les gros éditeurs, donc, on vient d’en avoir la preuve – ils n’attaqueraient pas, sinon : ni pour Dutourd, ni pour une cinquantaine d’euros venus ou à venir. C’est fini, et on ne veut pas le voir. Publie.net propose autre chose, qui voit le jour grâce à l’enthousiasme et l’énergie terribles de quelques-uns. On devine comme il difficile de lutter, peu nombreux, contre tout. On leur met des bâtons dans les roues : c’est qu’ils ont raison, et comme les peuples qui se déplacent, c’est inévitable, la machine est en marche, ils avancent. Gallimard c’est fini. Il n’empêche, la bêtise nous met très en colère.
Derrière la bêtise, ou avec elle, faisant cortège, c’est bien la peur qu’il faut voir. Chez Guéant aussi, peut-être, quand il annonce comme en passant que toutes les civilisations ne se valent pas. Le pire n’est pas Guéant. Le pire vient derrière : Luc Ferry, (philosophe et ex ministre de l’éducation nationale, là où non plus ça ne marche pas, pas du tout, plus du tout, c’est complètement fini et pas grand monde n’y fait le gros boulot que fait Publie.net par ailleurs[1]), Luc Ferry, donc y va d’un drôle de couplet. Là, on ne peut plus interroger la peur ni la bêtise ni quoi que ce soit. On est au-delà. « Au nom de quoi, a dit Ferry pour défendre Guéant, pourrait-on refuser à quelqu’un le droit de préférer les traditions qui ont engendré une grande littérature à celles qui commandent les sociétés sans écriture ? ». D’abord, on le voit tout de suite, Luc Ferry a lu Dutourd et c’est tout. En effet, s’il savait quelque chose de quelque grande littérature que ce soit (s’il en avait reçu quelque chose) il serait prudent, avisé, subtil. Que sait Ferry des sociétés sans écriture ? Je vous parle d’un pays où la littérature a été jusqu’au XVIème siècle écrite en basque. Puis plus écrite, pour raisons jacobines d’un côté et fascistes de l’autre. Mais toujours composée. Précisément, avec art, règles, codes et passion. Et de nouveau écrite. Pas encore traduite. Luc Ferry n’a lu que Dutourd. Peut-être pourrait-il, s’offrant un abonnement à Publie.net, découvrir, outre de nouvelles traductions, de nouvelles littératures. Et l’histoire de la lecture comme la raconte Bon dans Après le livre. Afin de comprendre que ce n’est pas linéaire cette affaire. L’objet ne l’est pas. La lecture ne l’est pas. L’écriture ne l’est pas. Et les sociétés sans écriture en ont une que n’a pas Luc Ferry. La bêtise n’a pas de limite, la colère oui.
Quant à moi je vais voter Hollande. Les temps sont durs, votons pour un mou. C’est Pierre Dac qui rêvait le parti des mous. Au moins, on pourra bouger là dedans, tenter de faire bouger, attaquer, bousculer.
[1] En fait, plein de gens font le boulot. Mais on ne le voit pas paraître encore. Je pense à Stiegler, Meyrieu, Ars industrialis
Dans la collection REPRINT de Publie.net
 Dans le collection REPRINT de Publie.net
Dans le collection REPRINT de Publie.net
Noces de Mantoue
Déplacements
André des ombres
On en parle :
Se les procurer :
Adieu la vie adieu l'amour
C’est le titre d’un des pemiers livres de Juan Marsé. Après Teresa l’après-midi et La généalogie des rêves traduit récemment (Christian Bourgois), j’ai découvert Enfermés seul avec un jouet, L’étrange disparition de R.L Steveson, Adieu la vie, adieu l’amour. Dans les romans de Juan Marsé, on est après la guerre civile, en Catalogne.
La plupart de ceux, réfugiés au pays basque nord, qui, dans les années 70, étaient de l’autre côté de la frontière dans l’oeil du cyclone, disent aujourd’hui avoir tourné la page. Des vagues de réfugiés se sont succédé, et c’est sans parler de la dernière guerre carliste dont la génération des arrière grands parents ont gardé mémoire. J’ai tourné la page. J’ai lu des chroniques, des journaux de l’époque, j’ai parlé avec Arnaud, Xabi. Je n’ai pas lu de récits, de grands récits. Le récit est en suspens. La lutte armée a pris toutes les forces.
Avant Marsé j’ai lu Benet, Sender, les longs labyrinthes de Max Aub. Encore Barcelone. Dans la préface à la deuxième édition de Adieu la vie adieu l’amour, Marsé écrit : “quand j’ai écrit ce roman, j’étais convaincu qu’il ne serait pas publié. C’était entre 1968 et 1970. Le régime franquiste paraissait établi à jamais et une idée déprimante me hantait : j’étais persuadé que la censure qui jouissait alors d’une santé florissane survivrait à nous tous, au régime fasciste qui l’avait engendré et à la transition tant espérée (ou à la rupture, comme l’appelaient beaucoup d’aspirations déçues) et s’installerait pour l’éternité, tel un mauvais sort jeté par le Caudillo au coeur même de l’Espagne future.”
A la fin du roman, les anciens de la FAI, dans les vieux quartiers de Barcelone, se retrouvent 20 ans après. 20 ans après. Ce 20 ans après me fascine, peut-être à cause d’un livre d’enfance … Sans doute parce que ce sont alors les corps, l’expérience, la durée, la triste durée et la désespérance mêlée à de tout petits arrangements qui sont en question. En tout cas Lage et Palau survivants FAIistes se retrouvent, vie broyées Et Marsé écrit :
“Palau écrasé dans la foule sans pouvoir se retourner, ce corps lourd et épais, coincé entre les nuques et les épaules, qui n’arrive pas à se mettre à l’aise ni à s’imposer, qui aurait cru ça de lui autefois, quand un sang jeune bouillait encore dans nos veines, quand tout était perdu sauf l’espérance, à cette époque nous pensions tous ça ne peut pas durer mais ils sont toujours là ceux qui pensent aujourd’hui que ça ne peut pas pas durer, il faudra bien que ça finisse un jour, impossible que ça tienne longtemps, sans savoir que ces propos parviendraient comme un écho vide aux oreilles sourdes de leurs enfants et de leurs petits enfants : ils étaient vraiment aveugles, irrémédiablement vaincus et ils étaient bien loin d’imaginer de reprendre les armes, ils n’y pensaient même plus, maintenant ils n’avaient même plus assez de cran pour s’imaginer la tête dans un passe montagne, pistolet au poing, poussant le tourniquet d’une banque ou plaçant un explosif”.
Ailleurs, ils continuèrent ils imaginèrent, enfants et petits enfants, ont eu du mal à cesser d’imaginer – aveuglés non par le non savoir mais par trop de savoir et par trop de mémoire. Erreur tragique – quand on est vaincu et qu’on se dresse encore, quand le droit fait du malheureux un coupable – comme dit Walter Benjamin après Goethe, du misérable vous faites un coupable.
Alors ? Alors je n’ai pas lu beaucoup de grands récits, je n’en ai pas entendu beaucoup, ou alors en douce, auréolés de secrets et de silence. Mais je sais que tout coupables qu’ils se firent, ils furent, ces vaincus de vaincus, moins vaincus que Louis Lage, que Palau, que Marcos Javaloyes dans le roman de Marsé.
